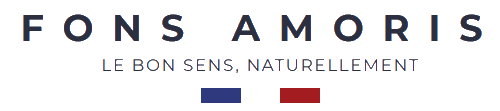La marmite norvégienne dans les âges
Histoire
La marmite norvégienne, malgré son nom, n’est pas une invention exclusivement scandinave. Ce dispositif ingénieux, destiné à cuire les aliments sans feu, repose sur un principe très ancien : celui de la conservation de la chaleur. Le concept apparaît dès l’Antiquité : les Romains enfouissaient déjà leurs plats dans des fosses isolées de paille pour terminer la cuisson lentement. Mais c’est au XIXᵉ siècle que la marmite norvégienne prend sa forme moderne.
En 1867, un ingénieur norvégien du nom de Heyerdahl perfectionne et popularise ce procédé en Scandinavie. À l’époque, on l’appelait « kasseapparat » ou « boîte à cuisson ». Le principe était d’une simplicité géniale : on portait un plat à ébullition, puis on plaçait la marmite brûlante dans une caisse isolée, garnie de foin, de laine ou de liège. La chaleur emmagasinée suffisait à poursuivre la cuisson pendant des heures, sans consommer davantage de combustible.
Pendant la Première Guerre mondiale, la marmite norvégienne connaît un essor spectaculaire, surtout dans les foyers européens soumis aux restrictions alimentaires et énergétiques. Le charbon et le bois devenaient rares, et toute économie de combustible était précieuse. Les gouvernements encouragèrent l’usage de ce système ingénieux : en France, le ministère du Ravitaillement diffusait des brochures expliquant comment fabriquer sa propre marmite norvégienne à partir de caisses à biscuits ou de paniers d’osier. Les journaux féminins de l’époque, comme La Femme Pratique, en faisaient la promotion, vantant son efficacité et sa modernité : « Un pot-au-feu sans feu, voilà le secret des ménagères patriotes ! » Certains témoignages rapportent même que des soldats, en permission, confectionnaient ces marmites pour leurs familles afin de leur faciliter la vie en leur absence. Ce simple objet domestique devint ainsi un symbole d’ingéniosité, de solidarité et de résilience en temps de guerre.
Une autre page fascinante de son histoire s’écrit dans le froid du Grand Nord. Lors de l’expédition polaire de 1910, dirigée par le Norvégien Roald Amundsen, les explorateurs utilisèrent une version adaptée de la marmite norvégienne pour économiser le précieux carburant nécessaire à faire fondre la glace et à préparer leurs repas. Les conditions extrêmes rendaient chaque ressource vitale. Les caisses isolées, souvent faites de bois et de peaux, permettaient de conserver la chaleur des ragoûts et soupes pendant des heures, même par -30°C. Certains récits d’expédition rapportent que ces marmites improvisées contribuèrent à la réussite de la conquête du pôle Sud en 1911, en permettant à l’équipe d’Amundsen de rester nourrie et en bonne santé avec un minimum de ressources.
Aujourd’hui, la marmite norvégienne connaît un retour en grâce. Redécouverte par les adeptes du slow cooking et des pratiques écologiques, elle symbolise une forme d’intelligence durable : faire plus avec moins, respecter les ressources, et retrouver le plaisir d’une cuisson douce et naturelle. Qu’elle soit en bois, en liège, en tissus isolants ou même en version moderne à isolation sous vide, elle reste un héritage vivant d’une longue tradition d’ingéniosité humaine — un pont entre les savoirs anciens et les défis énergétiques du futur.